 On dit que les histoires courtes sont les meilleures. Sans doute, mais écrire une histoire courte suppose de créer un monde en quelques lignes et de le dissoudre de la
même manière par une chute qui doit ravir le lecteur. Ce qui ne doit pas être chose aisée et me rend admiratif.
On dit que les histoires courtes sont les meilleures. Sans doute, mais écrire une histoire courte suppose de créer un monde en quelques lignes et de le dissoudre de la
même manière par une chute qui doit ravir le lecteur. Ce qui ne doit pas être chose aisée et me rend admiratif.
Pour quelques stations de métro, dont le titre reprend, comme c'est souvent l'usage, celui d'une des nouvelles, est un recueil de trente-trois nouvelles qui ne représentent que quelques pages chacune, des histoires courtes en somme.
Gilles de Montmollin les a regroupées en trois grands thèmes, qui sont des thèmes de vie: l'amour, les valeurs, la mort.
Sur le thème de l'amour, l'auteur dresse notamment le portrait d'hommes qui se méprennent sur les intentions de la gente féminine à leur égard, qu'ils croyaient pourtant explicites. L'un d'eux se pose alors cette question lancinante:
"Vaut-il mieux tenter de vivre ses rêves, ou simplement rêver pour survivre à ses déboires?"
La méprise n'est d'ailleurs pas uniquement masculine. Elle peut être tout autant féminine... Surtout depuis que, plus souvent
que naguère, des femmes prennent l'initiative dans les rapports amoureux.
Quand il n'y a pas méprise, "en amour, il y a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie", s'entend dire un des personnages de l'auteur. Décidément, c'est pas facile l'amour...
Sur ce thème de l'amour, l'auteur traite bien sûr d'autres aspects et, particulièrement, celui du hasard qui fait parfois bien les choses ou, plutôt, qui rend possibles les rencontres improbables, après des phases d'observation que l'on croyait sans conséquences...
Le thème des valeurs n'est pas moins vaste. Montmollin effleure les sujets de la vanité de la réussite matérielle, de la vengeance, du jugement porté sur la société sans se remettre en cause soi-même ou de l'empathie que l'on éprouve pour quelqu'un et qu'on lui témoigne sans qu'il ne demande rien.
Mais, si la réussite matérielle n'est pas tout, son absence peut n'en avoir pas moins quelques conséquences ou conduire à des réactions disproportionnées sous l'effet d'une honte mal placée...
Doit-on cacher la vérité qui fait mal? Doit-on se résigner, et accepter de se plier aux nouvelles moeurs, parce que le monde autour de soi change, sous prétexte de ne pas heurter les autres, ou, au contraire, se rebeller? Doit-on se réfugier dans le monde virtuel? Autant de questions que les personnages de Montmollin se posent, sans apporter toujours des réponses qui satisfont.
J'aime toutefois ce grand-père qui dit à son petit-fils:
"Je me regrette parce que je n'ai pas toujours su apprécier les beaux moments de ma vie [...]. Mais aujourd'hui j'y parviens... Tu vois, l'important c'est d'y arriver un jour."
Avec le troisième thème de ce recueil, les histoires courtes trouvent des épilogues mortels, ou presque, comme il se doit.
Une mort peut en cacher une autre. Le pire n'est jamais sûr. Le déni de réalité ne dure pas éternellement et l'on n'apprécie les choses qu'au moment où elles vont manquer. La visualisation d'un instant de bonheur passé peut dissuader de commettre l'irréversible. L'irresponsabilité d'une mort ne se trouve pas chez qui l'on pense.
Gilles de Montmollin a le don de créer un monde avec une grande économie de moyens. Les descriptions des êtres et des choses sont brèves, mais suffisamment précises pour exciter l'imagination du lecteur. Il dessine en quelques traits les caractères de ses personnages, qu'il s'agisse de leurs comportements ou de leurs paroles.
Gille de Montmollin connaît très bien les véhicules automobiles et les amateurs apprécieront ce qu'il en dit et de quel genre en sont les conducteurs. De même les fervents de la navigation à voile, ou même à vapeur, ne seront pas dépaysés, sans indisposer pour autant les autres.
Sous la légèreté apparente, parfois, des propos, se cachent, à peine, leur profondeur et leur gravité. C'est pourquoi, même si la lecture de ces nouvelles courtes peut se faire pendant de courts trajets, le lecteur est touché par ce qu'elles révèlent de vécu humain et les prolonge, pour lui-même, dans son monde intérieur.
La distraction jointe à la réflexion, que demander de plus à des histoires courtes qui savent bien chuter?
Francis Richard
Pour quelques stations de métro, Gilles de Montmollin, 160 pages, Editions Mon Village




 On connaissait Antonio Albanese musicien, enseignant, romancier. On sait maintenant qu'il peut être diariste, mais un diariste
bien singulier.
On connaissait Antonio Albanese musicien, enseignant, romancier. On sait maintenant qu'il peut être diariste, mais un diariste
bien singulier.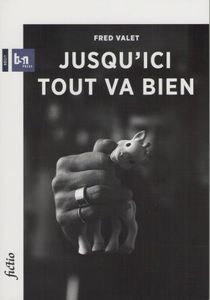 Ce n'est pas une mince affaire que de devenir père. J'ai expérimenté. Et mon fils aîné a exactement la moitié de mon âge cette année...
Ce n'est pas une mince affaire que de devenir père. J'ai expérimenté. Et mon fils aîné a exactement la moitié de mon âge cette année... Babylone est le nom d'une ville dont on n'a retrouvé que des vestiges. C'est le symbole par excellence de la décadence et de l'orgueil, avec sa
tour. Du moins est-ce ainsi qu'elle est présentée dans les Ecritures.
Babylone est le nom d'une ville dont on n'a retrouvé que des vestiges. C'est le symbole par excellence de la décadence et de l'orgueil, avec sa
tour. Du moins est-ce ainsi qu'elle est présentée dans les Ecritures.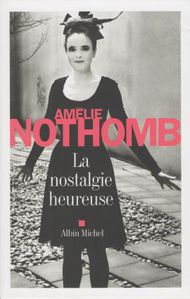 A la date habituelle, fin août, un Nothomb sort. Cette année ne fait pas exception à ce rite littéraire qui perdure depuis vingt et un ans et qu'observe
son éditeur avec la régularité d'un métronome.
A la date habituelle, fin août, un Nothomb sort. Cette année ne fait pas exception à ce rite littéraire qui perdure depuis vingt et un ans et qu'observe
son éditeur avec la régularité d'un métronome. En moins de deux ans, Quentin Mouron en est à son troisième roman publié. Chez le même éditeur.
En moins de deux ans, Quentin Mouron en est à son troisième roman publié. Chez le même éditeur.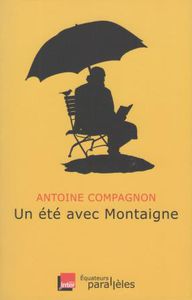 Philippe Val a demandé à Antoine Compagnon de parler des Essais de
Montaigne chaque jour de la semaine de l'été 2012 (du 2 juillet au 24 août) sur l'antenne de France Inter. C'était une gageure. Le professeur au
Collège de France l'a tenue.
Philippe Val a demandé à Antoine Compagnon de parler des Essais de
Montaigne chaque jour de la semaine de l'été 2012 (du 2 juillet au 24 août) sur l'antenne de France Inter. C'était une gageure. Le professeur au
Collège de France l'a tenue.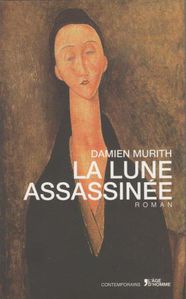 Dès les premières lignes de certains romans, non seulement le décor est planté, mais également se manifeste une atmosphère particulière que le lecteur est invité à respirer et qui ne
cessera de l'accompagner tout du long.
Dès les premières lignes de certains romans, non seulement le décor est planté, mais également se manifeste une atmosphère particulière que le lecteur est invité à respirer et qui ne
cessera de l'accompagner tout du long. Antonio Hodgers et sa femme, Sophie Balbo, ont écrit un livre à quatre mains.
Antonio Hodgers et sa femme, Sophie Balbo, ont écrit un livre à quatre mains. Il y a eu le confessionnal, puis le divan. Maintenant il y a le banc.
Il y a eu le confessionnal, puis le divan. Maintenant il y a le banc.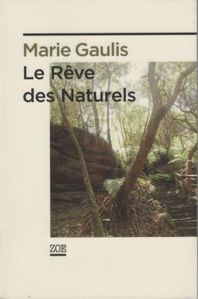 Qui pourra un jour départager ce qu'il y a en chaque homme d'inné et d'acquis?
Qui pourra un jour départager ce qu'il y a en chaque homme d'inné et d'acquis? Bien souvent, dans une famille, il se trouve quelqu'un pour régenter tout le monde, évidemment pour le plus grand bien de chacun, ce quelqu'un
s'estimant, en outre, indispensable. Dans la plupart des cas il s'agit du père, mais il est d'autres configurations possibles.
Bien souvent, dans une famille, il se trouve quelqu'un pour régenter tout le monde, évidemment pour le plus grand bien de chacun, ce quelqu'un
s'estimant, en outre, indispensable. Dans la plupart des cas il s'agit du père, mais il est d'autres configurations possibles. Pablo Picasso était l'aîné de vingt ans d'André Malraux, et ils sont morts à trois ans d'intervalle, Pablo
précédant André dans l'au-delà, il y a tout juste quarante ans.
Pablo Picasso était l'aîné de vingt ans d'André Malraux, et ils sont morts à trois ans d'intervalle, Pablo
précédant André dans l'au-delà, il y a tout juste quarante ans./image%2F0932890%2F20190405%2Fob_33f25c_peppa.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.wikio.fr%2Fshared%2Fimages%2Fadd-rss.gif)

/http%3A%2F%2Fstatic.technorati.com%2Fpix%2Ffave%2Ftech-fav-1.png)