 Dans L'Hebdo du 20 septembre 2012 on peut lire cette brève, mise en marge, sous les projecteurs:
Dans L'Hebdo du 20 septembre 2012 on peut lire cette brève, mise en marge, sous les projecteurs:
"En réaction à la polémique suscitée par la publication de son nauséabond Eloge
littéraire d'Anders Breivik, Richard Millet se retire du comité de lecture des Editions Gallimard, maison dans laquelle il continuera pourtant de suivre les auteurs dont il avait la
charge."
L'Hebdo résume en ces termes le "pamphlet antimulticulturalisme" de 17 pages qui
avait alarmé Jérôme Garcin, Jean-Marie Le Clézio et Annie Ernaux :
"Millet écrivait que la tuerie de l'île d'Utoya était "sans doute ce que méritait la
Norvège"."
Comme je me méfie des médias, j'ai voulu aller voir de plus près ce que disait Richard Millet dans ce texte au titre provocateur
et, dans la foulée, j'ai lu les trois petits livres, petits par le nombre de pages, qui viennent de paraître sous sa signature, dont l'un comprend le "pamphlet" qualifié de "nauséabond" par L'Hebdo.
Richard Millet souffre. Et, comme il est écrivain, il souffre littérairement. Dans ses trois livres parus ce mois-ci il exprime
ce qui le fait souffrir.
En qualité d'écrivain, il dit souffrir que la langue française soit manipulée, détruite, malmenée par "l'oralité la plus basse", qu'elle ne soit plus un instrument de connaissance et qu'elle devienne un outil de propagande, que le style soit évacué au profit de
l'écriture:
"Ecrire revient donc la plupart du temps à faire état d'une indigence syntaxique, sémantique,
anthropologique, culturelle, dans laquelle la langue n'existe pour ainsi dire plus."
Il voit au contraire dans le style "une sorte d'éternité, ou de dilution du temps en lui-même,
pour celui qui écrit".
L'écrivain ne peut être que solitaire. S'il veut rester styliste, envers et contre tout, il doit jouer sa "nullité économique contre la reconnaissance symbolique donnée par des agences de notation" où il ne se reconnaît pas; il doit "parler depuis
cet étrange lieu qu'est la nullité sociale de l'écrivain", à qui ce qui peut arriver de pire est d'être "consensuel" s'il est parvenu au sommet de son
art.
Pour être libre l'écrivain doit renoncer "aux signes de la richesse littéraire, autrement dit la
respectabilité, les récompenses, les honneurs." Millet fait dire à son autre lui-même qu'est le narrateur d'Intérieur avec deux femmes :
"C'était en écrivain déclassé, marginal, solitaire, que j'entendais vivre ce qui me restait de
vie, sans céder en rien à ceux qui me déclarent détestable, sinon infréquentable."
Ce sont l'insignifiance et le divertissement généralisé qui font souffrir Richard Millet. Ainsi souffre-t-il que le roman se
réduise désormais à sa seule intrigue au détriment du style. Il parle alors de roman international et de roman post-littéraire qui s'imposent par le terrorisme économique; il parle de mort de la
littérature dans le roman.
Richard Millet souffre que la littérature soit méprisée, voire haïe, parce qu'"on préfère la
pauvreté de l'illusion à la richesse du réel". Il constate que la démarche créatrice aujourd'hui "conduit à se fuir au lieu de se confronter aux divers ordres
de temporalité humaine, notamment à cette expérience de la profondeur et du sens, c'est-à-dire de Dieu, selon Steiner, et sans laquelle il n'y a pas d'art."
Il ne cherche pas à dialoguer, ni à débattre:
"Je me situe d'emblée hors dialectique; je me contente de dire, de témoigner, de me tenir dans la
pure affirmation, cette pureté fût-elle perçue comme guerrière."
Il est sincère quand il écrit:
"Dire la vérité est un acte insurrectionnel: je ne serais pas écrivain si je mentais ou me
taisais."
Qu'affirme-t-il? Il affirme que "le capitalisme est la dégradation infinie de l'Autre au nom même
de l'altérité" (il le rend responsable de l'immigration massive et continue en Europe et l'accuse d'être l'allié de l'islamisme) et il affirme que les deux piliers du Nouvel Ordre Mondial
sont le Marché et le Droit.
Richard Millet souffre de la médiocrité ambiante et il oppose le monde vertical au "monde
horizontal, où le Marché et le Droit définissent apparemment l'espace infini mais en réalité restreint, mesuré, surveillé, sinon perverti, de l'échange, et dans lequel l'Autre est devenu le Même
sous la forme de simulacres, le faux ayant remplacé le vrai, la vérité n'étant plus que le prétexte du faux, et la transparence l'ombre du mensonge."
Richard Millet, "Français de souche et de race blanche, hétérosexuel, catholique", est
particulièrement soucieux de ce qu'il a reçu en héritage, notamment la langue, et de le transmettre à son tour. Il souffre et pose la question:
"Est-il criminel de prétendre nommer les choses, et dire non seulement la couleur des gens, leur
ethnie, leur race, leur comportement [...] mais aussi la douleur qui est mienne à constater que ce dans quoi on m'a élevé est décrété obsolète, voire nocif?"
L'idéologie antiraciste empêche l'écrivain qu'il est "de dire littérairement la vérité sur la
France, notamment sur l'immigration extra-européenne". Elle a besoin d'inventer du racisme "pour justifier la terreur qu'elle exerce sur tout le monde"
et les antiracistes se livrent "au nom du Droit, à ce dans quoi se sont illustrés les plus violents racistes: lynchage médiatique, condamnation judiciaire,
destruction de l'homme libre".
Richard Millet s'insurge contre cette intimidation majeure :
"Prétendre que remarquer qu'on est le seul blanc dans une station du RER implique que l'on eût
envoyé en d'autres temps des Juifs à Auschwitz."
Il souffre d'admettre qu'"il n'y a plus de peuple français, mais un assemblage ethnico-social
auquel le Marché et le Droit donnent l'illusion d'un ensemble homogène".
En fait dans ces trois livres Richard Millet reprend et développe des thèmes qu'il avait abordés dans La fatigue du
sens , dont j'ai rendu compte ici sur ce blog. J'écrivais:
"Richard Millet ne voit pas que l'immigration massive ne résulte pas de la libre circulation des
personnes, qui est une bonne chose [...] . Si elle massive, ce n'est pas du fait du libéralisme, ni de la mondialisation des échanges, qui est également une bonne chose, mais du fait du
mondialisme, idéologie qui conduit à établir un gouvernement mondial, à réglementer les échanges, à uniformiser les esprits et à plonger dans la misère les pays extra-européens d'émigration, qui
sont également paupérisés parce qu'ils ont à leur tête des dirigeants corrompus et restreignant les libertés."
J'ajoutais:
"Du fait de la déchristianisation, les Européens, au lieu de profiter du bien-être matériel dont
ils jouissent pour se consacrer à des aspirations spirituelles, s'adonnent à l'hédonisme, qu'encouragent en plus les Etats-Providence. C'est la pente des hommes, plus enclins, du fait de leurs
faiblesses, à l'horizontalité qu'à la verticalité. C'est ce qui les fait renoncer à l'intelligence, à l'héritage, à la profondeur, à l'effort."
C'est pourquoi je suis convaincu que seul le retour aux valeurs judéo-chrétiennes et aux racines gréco-latines, c'est-à-dire le
retour aux valeurs de liberté et de responsabilité qui en découlent, peut permettre d'empêcher "l'accomplissement accéléré d'une décadence".
Pour en revenir au début de cet article, l'éloge littéraire que fait Richard Millet d'Anders Breivik n'est pas
celui que laisse supposer le titre et que fustigent les médias, habitués qu'ils sont à "décontextualiser, amalgamer, extrapoler, intimider, insulter, mentir,
éliminer pour composer une version fallacieuse du réel".
Richard Millet dit clairement qu'il désapprouve et condamne les actes injustifiables du Norvégien, qui sont insignifiants
"sur le plan de l'efficacité politique" et qui sont "au mieux une manifestation dérisoire de l'instinct de survie
civilisationnel".
Mais il a lu le "compendium" de 1'500 pages que le tueur a diffusé sur Internet. Et ce sont
les analyses pertinentes qu'il contient, selon lui, et qui correspondent à ses propres préoccupations, qui ont retenu son attention:
"Breivik nous rappelle, d'une manière dont la signature dessert la pensée (ou même l'abolit),
qu'une guerre civile est en cours en Europe."
Il apparaît plus comme un symptôme de décadence que comme un révélateur de sens:
"Breivik est, certes, le signe désespéré, et désespérant, de la sous-estimation par l'Europe du
multiculturalisme; il signale aussi la défaite du spirituel au profit de l'argent."
Richard Millet constate:
"La dérive de Breivik s'inscrit dans la grande perte d'innocence et d'espoir caractérisant
l'Occident, et qui sont les autres noms de la ruine de la valeur et du sens. Breivik est, comme tant d'autres inidividus, jeunes ou non, exemplaire d'une population devant qui la constante
dévalorisation de l'idée de nation, l'opprobre jeté sur l'amour de son pays, voire la criminalisation du patriotisme, ouvrent un abîme identitaire qu'accroît le fait de vivre une fin de
civilisation."
Richard Millet remarque:
"Breivik n'est pas raciste; ce ne sont pas des immigrés qu'il a tués, mais de jeunes Norvégiens de
souche, travaillant, selon lui (et là se trouve le coeur de l'affaire), à la dénaturation norvégienne."
Après avoir rappelé la vision lénifiante des auteurs de thrillers scandinaves, qui se font l'écho "d'un "exotisme" à domicile, derrière lequel on se refuse à considérer que le chant du muezzin sonnerait la mort de la chrétienté, donc la fin de nos nations", Richard
Millet écrit la petite phrase tronquée par L'Hebdo, qui a valu à son texte d'être traité de nauséabond:
"Dans cette décadence, Breivik est sans doute ce que méritait la Norvège et ce qui attend nos
sociétés qui ne cessent de s'aveugler pour mieux se renier, particulièrement la France et l'Angleterre; loin d'être un ange exterminateur, ni une bête de l'Apocalypse, il est tout à la fois
bourreau et victime, symptôme et impossible remède. Il est l'impossible même, dont la négativité s'est déchaînée dans le ciel spirituel de l'Europe."
Même si l'on ne partage pas le pessimisme ou la souffrance littéraire de Richard Millet, il est intellectuellement malhonnête de
déformer sa pensée...
Francis Richard
Langue fantôme, suivi de, Eloge littéraire d'Anders Breivik, Richard Millet, 126 pages, Pierre Guillaume de Roux ici
Intérieur avec deux femmes, Richard Millet, 144 pages, Pierre Guillaume de Roux ici
De l'antiracisme comme terreur littéraire, Richard Millet, 96 pages, Pierre Guillaume de Roux ici
Cet article est publié également sur lesobservateurs.ch
 Le veine de Don Juan est décidément inépuisable. Pourquoi Antonio Albanese n'y aurait-t-il pas creusé à son tour quelques pépites
sur un mode contemporain? Car, après tout, si le personnage n'apparaît nommément que tardivement, avec Tirso de Molina, il est vieux comme le monde historique connu.
Le veine de Don Juan est décidément inépuisable. Pourquoi Antonio Albanese n'y aurait-t-il pas creusé à son tour quelques pépites
sur un mode contemporain? Car, après tout, si le personnage n'apparaît nommément que tardivement, avec Tirso de Molina, il est vieux comme le monde historique connu.



 Dans L'Hebdo du 20 septembre 2012 on peut lire cette brève, mise en marge, sous les projecteurs:
Dans L'Hebdo du 20 septembre 2012 on peut lire cette brève, mise en marge, sous les projecteurs: Le livre sur les quais, Morges, 8 septembre 2012:
Le livre sur les quais, Morges, 8 septembre 2012: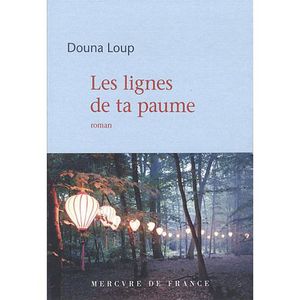 Les vingt premières années de notre existence sont déterminantes. Elles nous façonnent pour l'essentiel, malgré que nous en ayons, et font de
nous des femmes et des hommes marqués de manière indélébile par cette première tranche de vie.
Les vingt premières années de notre existence sont déterminantes. Elles nous façonnent pour l'essentiel, malgré que nous en ayons, et font de
nous des femmes et des hommes marqués de manière indélébile par cette première tranche de vie. Même en période de crise nous restons dans l'abondance. Nous sommes enclins à l'oublier.
Même en période de crise nous restons dans l'abondance. Nous sommes enclins à l'oublier.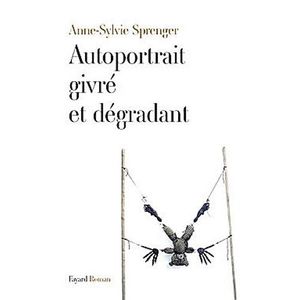 Anne-Sylvie Sprenger s'intéresse toujours à des personnages intenses, hors du commun. Il est d'ailleurs heureux qu'ils
soient hors du commun, parce que, sinon, pour le commun des mortels, ce serait...mortel.
Anne-Sylvie Sprenger s'intéresse toujours à des personnages intenses, hors du commun. Il est d'ailleurs heureux qu'ils
soient hors du commun, parce que, sinon, pour le commun des mortels, ce serait...mortel. Il fait chaud en ce mois d'août. Des jeunes filles et des jeunes femmes déambulent en short dans les rues que j'arpente, aussi
bien à Saint-Jean-de-Luz qu'à Lausanne, Cassis ou Aix-en-Provence.
Il fait chaud en ce mois d'août. Des jeunes filles et des jeunes femmes déambulent en short dans les rues que j'arpente, aussi
bien à Saint-Jean-de-Luz qu'à Lausanne, Cassis ou Aix-en-Provence.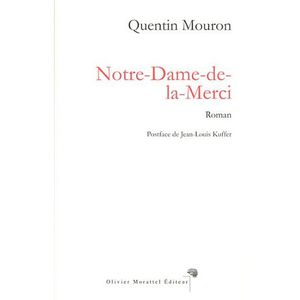 Au point d'effusion des égouts
Au point d'effusion des égouts 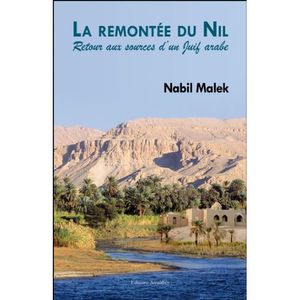 Reparti il y a quelque six mois avec ce fort volume sous le bras et une très amicale dédicace de l'auteur, je me suis demandé alors
quand je trouverais le temps de le lire.
Reparti il y a quelque six mois avec ce fort volume sous le bras et une très amicale dédicace de l'auteur, je me suis demandé alors
quand je trouverais le temps de le lire.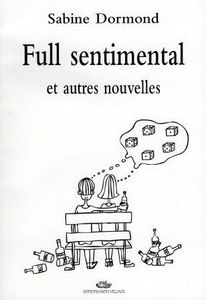 Finalement je suis de plus en plus convaincu que les histoires les plus courtes sont les meilleures. Le livre de
Sabine Dormond me le confirme.
Finalement je suis de plus en plus convaincu que les histoires les plus courtes sont les meilleures. Le livre de
Sabine Dormond me le confirme.  Le titre m'intriguait. J'ai donc fait l'acquisition du dernier livre de François Weyergans pour cette raison futile.
Le titre m'intriguait. J'ai donc fait l'acquisition du dernier livre de François Weyergans pour cette raison futile.  A la devanture d'une librairie de Saint Jean-de-Luz mon oeil est attiré par la couverture du livre de Luisa Etxenike.
A la devanture d'une librairie de Saint Jean-de-Luz mon oeil est attiré par la couverture du livre de Luisa Etxenike.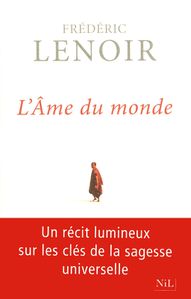 Depuis la nuit des temps d'aucuns tentent vainement de dire ce qui rassemble les hommes plutôt que ce qui les sépare.
Depuis la nuit des temps d'aucuns tentent vainement de dire ce qui rassemble les hommes plutôt que ce qui les sépare./image%2F0932890%2F20190405%2Fob_33f25c_peppa.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.wikio.fr%2Fshared%2Fimages%2Fadd-rss.gif)

/http%3A%2F%2Fstatic.technorati.com%2Fpix%2Ffave%2Ftech-fav-1.png)