Au début de cette année, l'affaire Dieudonné a occupé les derniers moments du ministre de l'Intérieur français Manuel Valls. Il n'avait, semble-t-il, rien de plus urgent à faire...
Les avocats de Dieudonné M'Bala M'Bala ont décidé de rétablir la vérité sur les reproches faits à leur client. Ils le font dans Interdit de rire, livre qui est en train de connaître, dès parution, un réel succès de librairie, au point d'occuper aujourd'hui une des premières places des ventes de livres de la FNAC et autres librairies en ligne.
Que les choses soient claires. Il est possible de rire de tout, mais je ne ris pas de tout. Ainsi l'humoriste Dieudonné, humoriste à succès, ne me fait pas toujours rire, loin de là. Henri Bergson, que citent opportunément les auteurs, disait: "Le rire n'a pas de plus grand ennemi que l'émotion" et, je le confesse, je suis un ardent et émotif philosémite...
Dans le même temps, je suis soucieux de vérité et inlassable défenseur de la libre expression, faisant mienne la déclaration attribuée à tort à Voltaire (ce qui prouve que ce n'est pas l'auteur d'un texte qui importe mais l'éventuelle bonne idée qui s'y trouve):
"Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire."
Or, quand "on" travestit la vérité, "on" finit par jouer contre son camp, a fortiori quand "on" se fait prendre la main dans le sac.
Maitres David De Stefano et Sanjay Mirabeau l'ont bien compris. Après la déferlante médiatique de début 2014, ils ont beau jeu de reprendre la main et de souligner les contre-vérités des adversaires de Dieudonné, qui n'ont pas su raison garder.
Le regretté Jean Ferré , chroniqueur au Figaro Magazine et fondateur de Radio Courtoisie, répétait qu'"un texte sans contexte est un texte con". Le traitement par les médias d'un extrait du spectacle Le Mur de Dieudonné où ce dernier met les rieurs de son côté en s'en prenant à Patrick Cohen, qui l'a tout de même traité préalablement de "cerveau malade", en est l'illustration.
Le contexte rétabli montre en effet que Dieudonné (qui se défend d'être raciste) joue, dans ce sketch, par dérision, le monstre que l'"on" prétend qu'il est... Ce n'est sans doute pas très fin, c'est même volontairement "monstrueux", mais c'est bien différent de ce qui a été dit et répété à l'envi. En faisant taire ses émotions, il faut prendre ce passage pour ce qu'il est, une bouffonnerie... comme des rois pouvaient en avaler jadis, en riant jaune.
De même le geste de la fameuse "quenelle" a été utilisé par Dieudonné dès 2005, dans son spectacle 1905, où il célèbre à sa façon le centenaire de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat:
"Dans la première partie du spectacle, Dieudonné nous parle de l'homme en tant que mammifère et de sa position inférieure dans la hiérarchie animale:
Le dauphin maintenant, quand il voit un homme, il se fout de notre gueule hi hi hi hi (imitation des sifflements du dauphin). Bien sûr, parce qu'il le sait lui que sa nageoire il va nous la foutre jusque-là Jacky (en réalisant le geste de la quenelle).
Joignant le geste à la parole, Dieudonné réalise une quenelle qui mesure la taille de la nageoire pour indiquer l'ampleur avec laquelle le dauphin se jouera des hommes."
Ce geste perd évidemment sa signification et même la renverse quand il est accompli par des énergumènes "devant des lieux de culte et de mémoire".
Les avocats de l'humoriste publient d'ailleurs la photo de la statue "du soldat de bronze, incontournable à Berlin, qui trône sur le mémorial soviétique de Tiergarten":
"Monumental, le soldat est debout sur un piédestal de marbre. Son bras gauche tendu vers le sol, salut nazi inversé, symbolise la chute du nazisme et la victoire de l'Armée rouge."
Ils concluent:
"La quenelle, un salut nazi inversé? Non, c'est le salut nazi inversé qui est une belle quenelle.
Au nazisme."
Maîtres De Stefano et Mirabeau ne seraient pas avocats s'ils n'abordaient pas le terrain juridique. Pour faire interdire les spectacles de Dieudonné en province - ils avaient eu lieu sans problèmes à Paris - les pouvoirs politique et judiciaire se sont donné la main pour tordre le cou à la libre expression en invoquant un imaginaire trouble exceptionnel à l'ordre public.
L'Etat est garant de l'ordre public. Les défenseurs de Dieudonné rappellent que le maintien de l'ordre public est composé de trois éléments distincts: la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.
Comme aucun de ces éléments ne peut être invoqué en l'occurrence, "on" lui ajoute deux éléments, le prétendu contenu du spectacle qui serait attentatoire à la dignité humaine - elle est indéfinissable juridiquement, mais le juge prétend la protéger -, et le casier judiciaire de l'artiste...
Le Conseil d'Etat, dans l'urgence, les 9, 10 et 11 janvier 2014, interdit donc par trois fois Le Mur, à Nantes, Tours et Orléans, en méconnaissance de cause, ce qui en dit long sur sa collusion avec l'exécutif, puisqu'il n'a pas visionné le spectacle, et, quant à lui, le juge des référés interdit, par précaution, le nouveau spectacle de Dieudonné, Asu Zao, que personne n'a encore vu et qui doit remplacer Le Mur à Orléans...
En fait, ce sont les pouvoirs exécutif et judiciaire qui se sont montrés indignes...
Il a été décidé en haut lieu d'abattre Dieudonné M'Bala M'Bala par tous les moyens, même légaux. Les interdictions de ses spectacles, en utilisant des arguments juridiques qui n'en sont pas, ne sont qu'un des aspects de la véritable chasse à l'homme qui est ouverte contre lui, contre les siens et contre ses fans.
Le 13 décembre 2013, le site de la société de production de Dieudonné est hacké donnant le signal de cette chasse à l'homme: les noms et adresses des visiteurs de ce site sont divulgués par le hacker.
A la suite de ces divulgations plusieurs personnes sont menacées et injuriées par mails, courriers, téléphone. Certaines d'entre elles perdent même leur emploi, dont l'une doit être internée dans un hôpital psychiatrique, "ne supportant pas la brutalité de son licenciement".
Fin janvier l'Etat se déchaîne contre Dieudonné: contrôle fiscal de sa société de production, gardes à vue, perquisitions à son domicile, à sa société de production, au théâtre de la Main d'Or et chez son expert-comptable.
Les noms des mille sept cents personnes qui ont prêté de l'argent à Dieudonné sont divulgués dans la presse. Les fans de Dieudonné font l'objet d'expéditions punitives à Lyon et Villeurbanne etc.:
"On a accusé et condamné Dieudonné pour incitation à la haine. La seule haine qu'il semble avoir provoquée est pourtant celle de ses adversaires envers sa propre personne."
... et envers ceux qui le soutiennent.
A ces persécutions s'ajoute un lynchage médiatique: Dieudonné ne paierait ni ses impôts, ni ses amendes; il organiserait son insolvabilité avec la complicité de sa compagne et de sa société de production.
Rien de tout cela n'est vrai. Le livre reproduit des documents de l'administration fiscale qui le prouvent indubitablement: il n'a pas de dette fiscale, sa compagne et sa société de production non plus. Les derniers paiements sont intervenus le 13 février 2014...
Le livre révèle que Dieudonné a même bénéficié d'une remise fiscale l'année précédente, le 1er février 2013. Elle s'élève à 197'103.88 euros... Ce qui faire dire aux auteurs, avec humour, à l'adresse de leurs "concitoyens qui font actuellement l'objet de contrôles et de redressements fiscaux":
"Si une remise de pénalités de près de deux cent mille euros a été accordée au monstre Dieudonné, il n'existe dorénavant plus aucun obstacle à ce que leur propre demande de remise de pénalités ne soit pas acceptée par les services fiscaux de notre pays."...
La meilleure protection en matière fiscale, c'est l'enregistrement. Les sommes prêtées à l'humoriste sont aujourd'hui toutes enregistrées, de même que les dons à hauteur de quatre cent mille euros qu'il a faits personnellement "à ses proches qui vivent au Cameroun, fils, frères, oncles, cousins et amis"...
Ce livre percutant a été adressé aux 577 députés de l'Assemblée nationale.
Ses auteurs les sollicitent de créer une commission d'enquête parlementaire "afin de connaître le fonctionnement et de déterminer les éventuels dysfonctionnements dans l'action du Gouvernement et des services de l'Etat, entre le 27 décembre 2013 et le 1er mai 2014, dans la gestion d'une affaire qui a conduit à la détérioration de la cohésion nationale".
Dans le cadre de cette enquête parlementaire, ils suggèrent toutes les questions qu'il conviendrait de poser aux personnes qu'ils citent lors d'auditions publiques...
Bref, tout est prêt - les propositions de résolution sont même rédigées - pour qu'un groupe de députés demande à ce que toute la vérité soit faite sur cette affaire.
Vous avez dit dignité de la personne humaine?
"Dieudonné est un spécialiste de l'indignité de la personne humaine. Son travail consiste précisément à la révéler, pour mieux la dénoncer."
Francis Richard
Interdit de rire, David De Stefano et Sanjay Mirabeau, 160 pages, Xenia
Publication commune avec lesobservateurs.ch






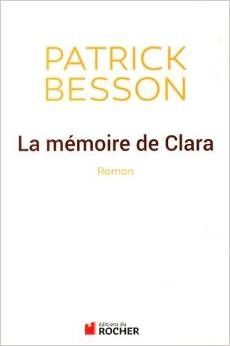




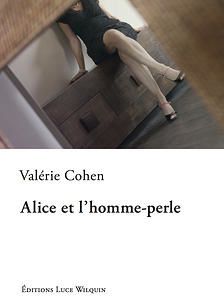

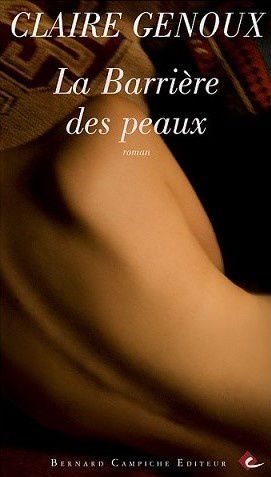



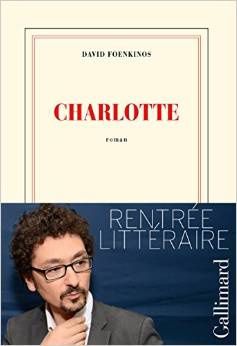

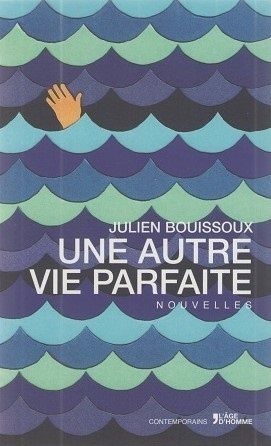
/image%2F0932890%2F20190405%2Fob_33f25c_peppa.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.wikio.fr%2Fshared%2Fimages%2Fadd-rss.gif)

/http%3A%2F%2Fstatic.technorati.com%2Fpix%2Ffave%2Ftech-fav-1.png)