Dans De l'esprit de conquête, Benjamin Constant disait il y a quelque deux siècles:
La variété, c'est de l'organisation; l'uniformité, c'est du mécanisme. La variété, c'est la vie; l'uniformité, c'est la mort.
Pourquoi penser à ces paroles du Lausannois, en lisant Rosa, le roman de Lolvé Tillmanns? Parce que les membres de la famille, dont ce roman est le récit, les illustrent: ils sont à la fois uniques et pluriels, c'est-à-dire qu'ils sont variés et ne sont pas uniformes. Dans le même temps, n'appartiennent-ils pas à une même famille?
Rosa Lévine, née Cohen, est au soir de sa vie. Elle demande, comme cadeau d'adieu, que chacun des membres vivants de sa famille accepte de raconter sa vie au micro de David Mancini, l'un de ses petits-fils, qui est chargé de mettre en forme par écrit ce qui lui aura été confié et qui n'apparaît pourtant pas le plus à même de remplir une telle mission.
Pour compléter ce Livre de Rosa, avec les mots des disparus, David pourra se servir de cassettes non numérotées que sa mère Rebecca, Becca, a enregistrées et montées minutieusement et où elle raconte sa propre vie, et des enregistrements, non numérotés non plus, qu'elle a faits de son père, cette fois sans les monter.
Des enregistrements des survivants réalisés avec le Nagra maternel - cela représentera finalement cent une cassettes - David s'inspirera librement pour rédiger la biographie de chacun. De plus il retranscrira les cassettes de l'autobiographie de Becca et s'inspirera également librement de celles qu'elle a enregistrées avec son père Isaac, un banquier genevois.
Après quoi, Rosa racontera à David son passé, sa jeunesse, comme il le lui a demandé vingt ans plus tôt. Et ce sera le dernier chapitre de l'histoire familiale. Ils se réuniront alors tous une dernière fois autour d'elle dans la chambre de son palace médicalisé, pour l'écouter, enveloppés qu'ils seront par la fragrance de son Chanel n°5.
Lolvé Tillmanns a disposé dans un ordre chronologique singulier les biographies des membres de la famille. En effet ces biographies remontent l'arbre généalogique au lieu de le descendre... Elles commencent ainsi par celle de la plus jeune, Lilah, et se termine par celle du vieil Isaac, mort trente-trois ans plus tôt.
Il résulte de cet ordre singulier que la biographie du membre suivant vient pour ainsi dire enrichir et compléter celle du membre précédent et que les mêmes événements sont vus tour à tour sous des angles différents et considérés avec une inégale importance par les uns et par les autres.
En début de volume, l'arbre généalogique de la famille est reproduit. En gras figurent ceux qui ont voix au chapitre dans le livre, qu'ils soient morts ou vivants. Cet arbre est d'une grande utilité pour le lecteur parce qu'il lui permet de situer les personnages dans le temps et de comprendre les liens qu'ils ont les uns avec les autres.
Si, au contraire de l'auteur, l'on descend l'arbre généalogique, on constate que les grands-parents Lévine - ils s'appelaient autrefois Lévy -, Isaac, né en 1920 (mort en 1980), et Rosa, née en 1930, n'ont eu qu'une fille, Rebecca, née en 1950 (morte en 1993). Cette dernière redeviendra Rebecca Lévy pour signer ses oeuvres artistiques...
Rebecca s'est mariée avec Mario Mancini, un italo-américain né en 1945. De leur union sont nés d'abord deux jumeaux, en 1971, Isaac et Aaron, puis David, en 1980, enfin Lilah Rose, en 1990. On remarquera que les naissances entre les enfants sont espacées à chaque fois d'une dizaine d'années. Peu à peu le lecteur comprend le pourquoi de cet espacement.
Les deux parents de Becca sont juifs et tous deux ont connu la Deuxième Guerre mondiale et ce n'est pas trahir l'intrigue que de dire qu'ils ont obligatoirement dû être affectés, d'une manière ou d'une autre, par la Shoah et par les camps de la mort. Mais, en raison de la chronologie inversée adoptée par l'auteur, ce n'est qu'à la fin que le lecteur saura comment.
Dans ces différentes biographies, même la sienne, placée en second, mais enregistrée en premier, David emploie la troisième personne. Seule l'autobiographie de Becca est racontée à la première personne. Cette façon de faire introduit une distanciation qui permet à l'auteur de ne rien céler de ce qui caractérise ces personnes, y compris leurs côtés les plus sombres, et ce de manière souvent incisive, presque chirurgicale.
L'habileté du procédé est de donner l'impression au lecteur qu'il approfondit à chaque lecture d'une des biographies d'un membre de la famille sa connaissance de la famille entière. Or à la fin du récit sa vision sera remise complètement en cause. Cette remise en cause posera la grande question de l'identité de chacun: existe-t-elle ou non indépendamment de la famille, de son histoire? Ou chacun construit-il la sienne?
Lolvé Tillmanns ne cache pas qu'elle s'est beaucoup documentée pour écrire ce roman qui se passe en Suisse et aux Etats-Unis. Une bibliographie sommaire en atteste, de même que quelques notes en bas de page. Il n'est pas inutile de le souligner. Car toutes ces connaissances donnent une intensité et une densité à ce livre bouleversant, dont on ne sort pas vraiment indemne...
Francis Richard
Rosa, Lolvé Tillmanns, 328 pages, Éditions Cousu Mouche
Livre précédent chez le même éditeur:
33 rue des grottes (2014)










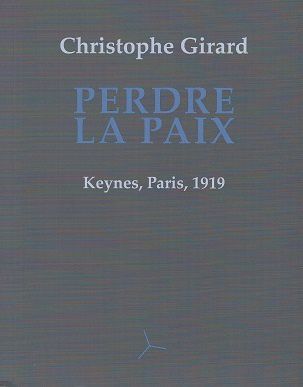

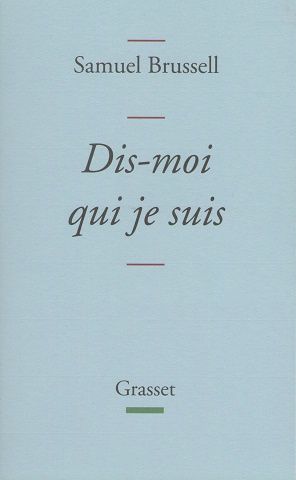
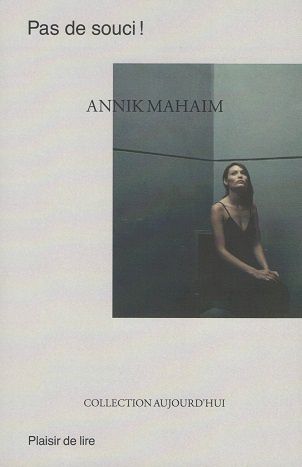



/image%2F0932890%2F20190405%2Fob_33f25c_peppa.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.wikio.fr%2Fshared%2Fimages%2Fadd-rss.gif)

/http%3A%2F%2Fstatic.technorati.com%2Fpix%2Ffave%2Ftech-fav-1.png)