Jours merveilleux au bord de l'ombre est le titre du dernier roman de Rose-Marie Pagnard. Il résume assez bien le contenu du livre: les jours merveilleux (pour l'un mais pas pour les autres) côtoient une ombre au tableau, une ombre qui plane sur cette histoire des années 1960.
Cette histoire est toute simple. Jakob Jakob a eu deux fils, à vingt ans d'intervalle, Räuben et Davitt. Le premier est un célibataire endurci (par son incapacité à séduire). Le second s'est marié à 20 ans avec Dorothée, qui lui a très vite donné deux enfants, Brun et Dobbie (pour Dorothée Billie).
Autant Räuben est intéressé par le pouvoir et l'argent, autant Davitt est surtout amoureux de sa femme, qui le lui rend bien. Autant Räuben est un tricheur et un voleur, autant Davitt est un naïf et un homme honnête, qui n'imagine pas que les autres puissent ne pas être comme lui.
Räuben est très riche. Cependant il ne doit pas sa fortune à son esprit d'entreprise mais à son art de tromper les autres. Une fois ses méfaits commis, cet esprit simple en a toutefois suffisamment pour leur faire croire, et faire croire à qui l'écoute, qu'il les comble de réels bienfaits.
Ainsi a-t-il dépossédé son père Jakob de sa fortune en usant vraisemblablement d'un faux, puis l'a installé à l'hôtel du Corsaire. Ainsi a-t-il fait porter le chapeau à son frère Davitt du détournement d'une taxe communale sur l'eau, puis l'a embauché dans son entreprise de feux d'artifice.
Comment réparer l'injustice (l'ombre) qui est faite à Davitt par son frère, c'est ce à quoi s'emploient Brun et Dobbie tout au long du récit, qui fait des va-et-vient dans le temps et dans l'espace et qui a quelque chose de fantastique: l'histoire elle-même ne discute-t-elle pas avec Dobbie?
Autour d'eux gravite les habitants insolites de leur ruelle misérable: Johann Schwarz, un professeur de musique, Petitemain, la fille adoptive de ce dernier, Valère Optik, un marchand de cristal, Berthie, un ami de Brun, Kari Matt, un voisin, Mato Graf, un comte improbable.
Le roman de Rose-Marie Pagnard plaira au lecteur qui aime partir dans tous les sens, perdre pied, se mouvoir dans un monde à la fois modeste et merveilleux, être stimulé par de tels contrastes, participer à des batailles contre les moulins à vent, comme le Don Quichotte de Cervantes...
Francis Richard
Jours merveilleux au bord de l'ombre, Rose-Marie Pagnard, 208 pages, Zoé


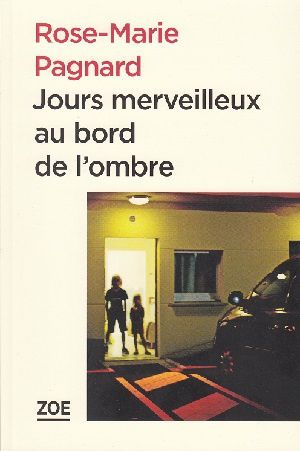


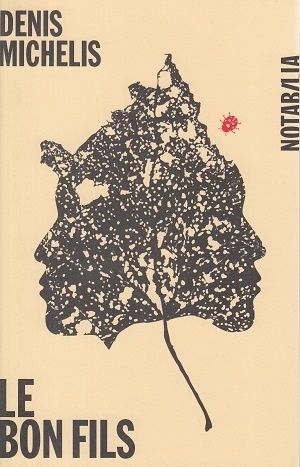

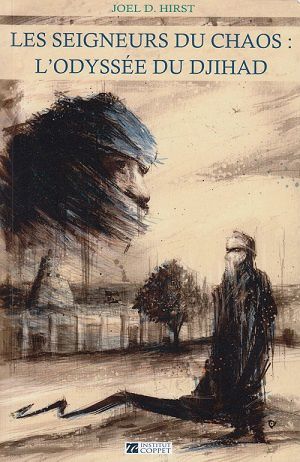





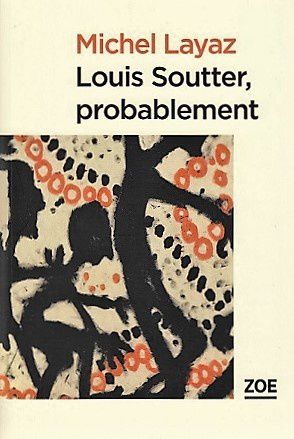



/image%2F0932890%2F20190405%2Fob_33f25c_peppa.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.wikio.fr%2Fshared%2Fimages%2Fadd-rss.gif)

/http%3A%2F%2Fstatic.technorati.com%2Fpix%2Ffave%2Ftech-fav-1.png)